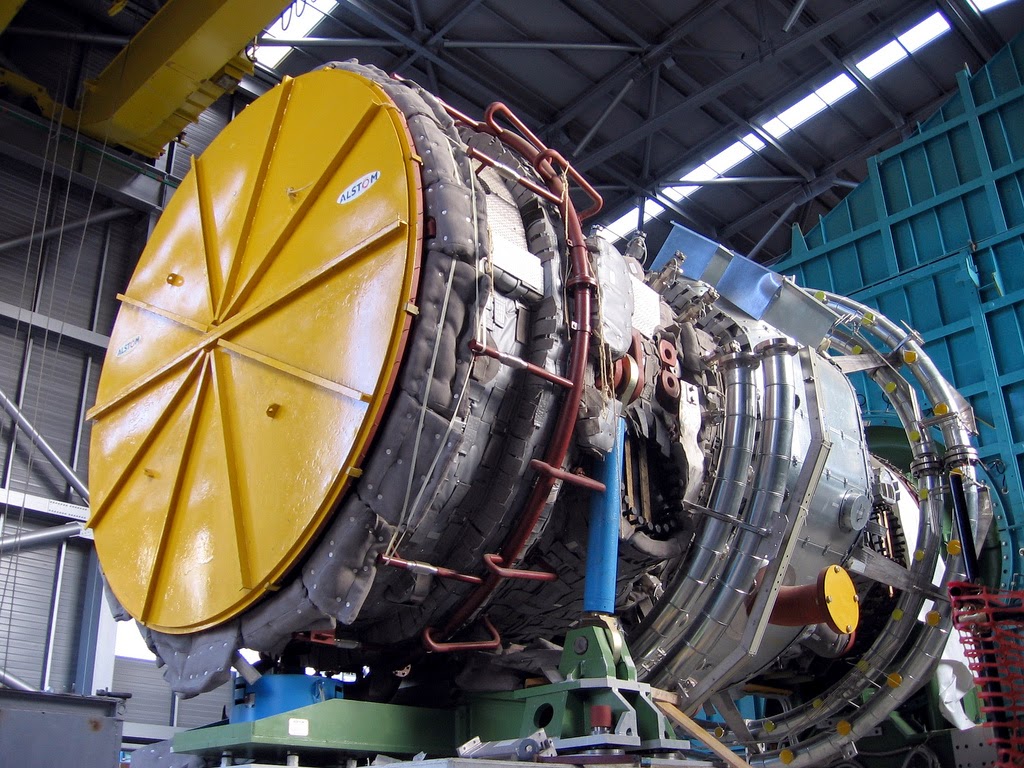Rendez-vous aussi sur la page facebook de Mediarail.be, ainsi que sur Twitter et LinkedIn
(english version)
Autres fiches synthèse - retour Homepage
Europe - tous pays
Beaucoup de gens sur internet parlent de train intermodal, sans vraiment distinguer ce qui est chargé dessus.
Conteneurs
Les conteneurs sont bel et bien une économie de nature océanique. Leur origine provient de la logistique militaire dont la méthode a été appliquée à l'économie maritime et portuaire, permettant aujourd'hui de charger et décharger plusieurs milliers de tonnes de/vers un navire en quelques heures. Les dimensions ont été approuvées par un comité économique et technique de l'ONU dans les années 60 et elles sont aujourd'hui devenues les dimensions ISO standards appliquées aux 15 millions de conteneurs en service dans le monde entier. A l'extérieur du terminal portuaire, les conteneurs peuvent être chargés sur des trains, des barges ou des semi-remorques, ce qui rend le concept de conteneur si «intermodal». En Europe, les dimensions sont toutefois légèrement plus courtes que sur une semi-remorque, ce qui conduit à ce que le «transport continental» soit entièrement généré par les transporteurs routiers et leurs semi-remorques, de plus grandes tailles.
Voir en détail les pages consacrées aux conteneurs
Voir en détail les pages consacrées aux conteneurs
Vidéo : terminal maritime à Hambourg et chargement
Vidéo : conteneurs déplacés par reach stacker (en)
Vidéo : à bord d'un reach stacker en opération
Vidéo : du côté du monde maritime - timelapse à bord d'un porte-conteneur et opérations terminales
Vidéo : conteneurs déplacés par reach stacker (en)
Vidéo : à bord d'un reach stacker en opération
Vidéo : du côté du monde maritime - timelapse à bord d'un porte-conteneur et opérations terminales
Semi-remorques
Les semi-remorques, ou camionnage, sont une technologie adoptée par l'économie de la route, le mode le plus utilisé pour le transport de fret terrestre. C’est le rival le plus sérieux des chemins de fer. Depuis 50 ans, quelques transporteurs routiers pionniers ont eu l'idée de charger des semi-remorques sur des trains, par un chargement vertical. Pendant de nombreuses années, la hauteur d'angle est restée la principale pierre d'achoppement du transport intermodal. En raison de la présence des roues, les semi-remorques doivent être chargées sur un wagon spécial équipé d'une poche surbaissée reccueillant les roues de la semi-remorque. Aujourd'hui, de nombreux wagons ultra surbaissés permettent de transporter des camions d'une hauteur de 4 mètres sur certaines lignes de chemin de fer, tels que la ligne du Gothard. Contrairement aux conteneurs, les semi-remorques ne peuvent pas être empilées. En effet, de nombreuses caisses se composent de bâches tirées sur une simple armature, ce qui ne les rend absolument pas rigides. Cela nécessite un équipement de manutention spécial avec quatre bras de préemption pour soulever la semi-remorque à partir de quatre points situés autour du cadre du plancher, comme illustré ci-dessous.
Video d'un chargement
La variante NiKRASA
Une variante existe aussi pour les semi non-déplaçables par grue, du fait de leur conception du châssis n'incluant pas les 4 points de levage. Son nom : NiKRASA, pour "Nicht KRAnebare SAttelauflierger". Il s'agit d'un plateau à même le sol sur lequel est amené la semi. La grue soulève alors le plateau et la semi et place l'ensemble sur le wagon. A destination, on fait l'opération inverse, le plateau ne quittant jamais les terminaux.
Une vidéo du concept NiKRASA
La variante NiKRASA
Une variante existe aussi pour les semi non-déplaçables par grue, du fait de leur conception du châssis n'incluant pas les 4 points de levage. Son nom : NiKRASA, pour "Nicht KRAnebare SAttelauflierger". Il s'agit d'un plateau à même le sol sur lequel est amené la semi. La grue soulève alors le plateau et la semi et place l'ensemble sur le wagon. A destination, on fait l'opération inverse, le plateau ne quittant jamais les terminaux.
Une vidéo du concept NiKRASA
Caisses mobiles
Elles ressemblent aux semi-remorques, mais sans leurs roues. Elles ne sont pas des conteneurs tels que décrit plus haut. L'avantage d’une caisse mobile est d'éviter le poids mort du camion avec ses roues, et de pouvoir être chargées sur tout type de wagons, sans plancher surbaissé. Son inconvénient est clairement sur le côté routier : contrairement aux semi-remorques, il y a deux châssis, un pour le camion, un deuxième pour la caisse elle-même, alourdissant la tare du camion. Le chargement est similaire à celui d’une semi-remorque, avec quatre bras de préemption pour soulever la semi-remorque à partir de quatre points situés autour du cadre du plancher, comme illustré ci-dessous.
La route roulante version germanique, est un transport ferroviaire de véhicules routiers complets, remorque et tracteur avec chauffeur, avec utilisation de wagons à plancher très surbaissé. C’est la version ferroviaire du ferry traversant la mer. C’est un transport accompagné car le chauffeur accompagne son camion à bord d’une voiture couchette ou d’une voiture-coach classique. Pour atteindre la hauteur de 4 mètres de coin, les wagons ont un plancher ultra-surbaissé sur toute leur longueur, ce qui exige des roues de wagon de très petit rayon, provoquant davantage d'usure. Il n'y a pas de grues, car le chargement est effectué par les chauffeurs de camions eux-mêmes. Cela exige que les camions se succèdent pour embarquer par une rampe d'accès au début du train, semblable à un embarquement sur ferry. La route roulante n’est pas vraiment concurrentielle en raison des coûts élevés des wagons à huit essieux, à l'exception de la navette Eurotunnel.
Vidéo : embarquement des véhicules
Vidéo : une ROLA à pleine vitesse en Allemagne
L'avenir est à l'horizontal...
Vidéo : une ROLA à pleine vitesse en Allemagne
L'avenir est à l'horizontal...
Au cours des dernières années, de nouvelles idées sont apparues au sein de l'industrie intermodale. On peut mentionner en premier lieu la société française Lohr Industrie, qui a lancé son concept Modalohr en 2003. Le système peut être comparé avec celui de la route roulante similaire à celle décrite ci-dessus, mais il utilise des wagons spécialisés pour le transport de remorques routières et de leur tracteur, en utilisant des bogies classiques qui évitent une forte usure des roues. Une autre idée nouvelle est le concept Megaswing développé par la firme suédoise Kockums Industrier. Il utilise aussi des bogies classiques, mais fournit deux avantages spplémentaires, par l'utilisation du wagon Megaswing comme une unité individuelle, d’une part, et par le fait que le wagon peut être chargé / déchargé sans grue, d’autre part. Ce concept peut intéresser de nombreuses entreprises qui ne veulent pas utiliser un terminal intermodal spécialisé tout en restant libres des horaires de manutention et de la gestion de leur propre chargement. Le dernier concept est encore plus révolutionnaire et vient d'Allemagne. CargoBeamer, c’est son nom, embarque les semi-remorques comme des voyageurs. Le système peut charger et décharger un train de 36 semi-remorques en seulement 15 minutes, en faisant glisser le plancher bas horizontalement depuis le wagon directement sur le terminal, comme le montre sa vidéo ci-dessous.
La video de Modalohr
La video de Kockums Industrier (Megaswing)
La video de Cargo Beamer
Le poids des intermédiaires dans la structure des coûts
Le schéma ci-dessous compare le déroulement d’une opération de fret par la route et par le rail. Lorsque des marchandises sont transportées par chemins de fer, apparaissent de multiples interfaces entre les différentes parties impliquées (expéditeur, entreprise ferroviaire (EF), gestionnnaire d’infrastructure (GI), etc.). La coopération de ces entités va de pair avec leur échange d’information, nécessaire au bon déroulement de la chaîne de transport. En transport routier, ces échanges d’information ont lieu entre les expéditeurs, destinataires et sociétés de transport, tandis qu’en transport ferroviaire, en raison des multiples interfaces, ces échanges d’information sont plus complexes, comme le montre l’illustration no 1. (source : bulletin de l'OTIF 1-2014)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------










.jpg)