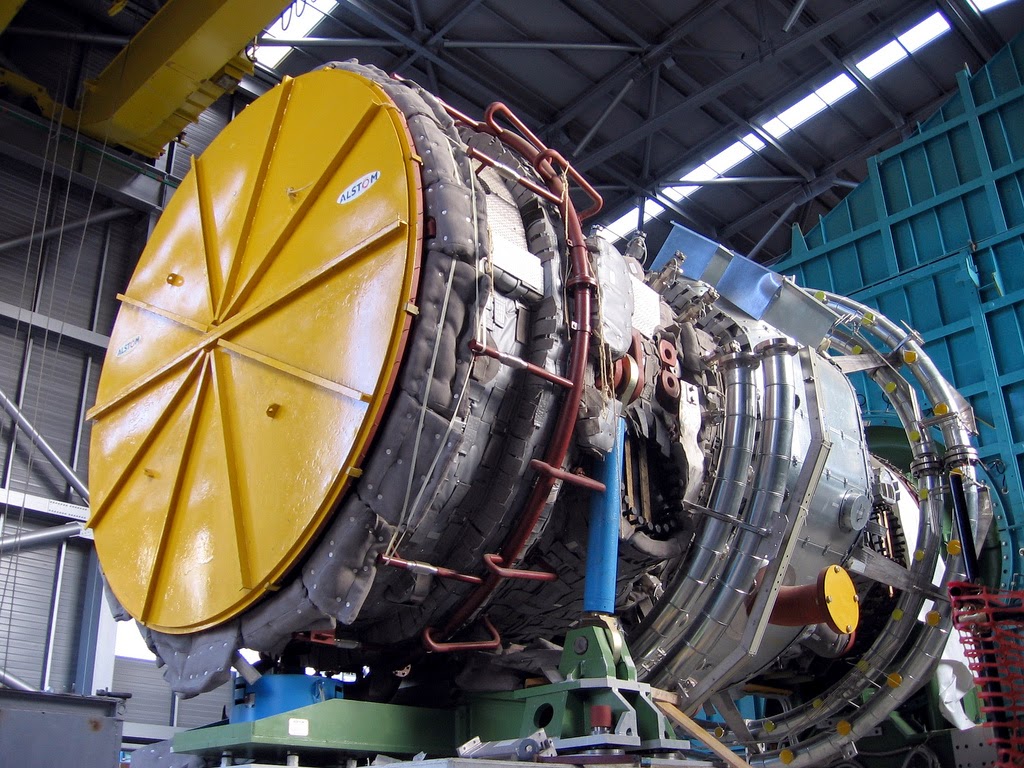Une nouvelle SNCF pour la France
Analyse de Mediarail.be - Technicien signalisation et observateur ferroviaire
Analyse de Mediarail.be - Technicien signalisation et observateur ferroviaire
Rendez-vous aussi sur la page facebook de Mediarail.be, ainsi que sur Twitter et LinkedIn
01/01/2015
Voir aussi : RFF – SNCF, qui décide du rail en France ? - Réforme SNCF : les réalités et les motifs
Voilà, c’est fait. La nouvelle SNCF est née ce 1er janvier 2015. Pour rappel, la structure actuelle est issue d’un vote intervenu le 23 juillet 2014 et officiellement promulguée par la Loi du 4 août 2014, en dépit des protestations du mois de juin qui avaient valus une dizaine de jours de grève en plein bac estudiantin. Très mal vu du public au point que la CGT s’en est pris contre des médias selon eux « orientés et désinformants ». Chacun appréciera…
01/01/2015
Voir aussi : RFF – SNCF, qui décide du rail en France ? - Réforme SNCF : les réalités et les motifs
Voilà, c’est fait. La nouvelle SNCF est née ce 1er janvier 2015. Pour rappel, la structure actuelle est issue d’un vote intervenu le 23 juillet 2014 et officiellement promulguée par la Loi du 4 août 2014, en dépit des protestations du mois de juin qui avaient valus une dizaine de jours de grève en plein bac estudiantin. Très mal vu du public au point que la CGT s’en est pris contre des médias selon eux « orientés et désinformants ». Chacun appréciera…
De quoi s’agit-il ?
D’une suite logique des Assises Ferroviaires initiées à l’époque
Sarkozy par Nathalie Kosciusko-Morizet, à l’automne 2011. Après de nombreux
remous, la solution définitive nous montre une « coupole » appelée SNCF
qui regroupe deux « filles » : SNCF Réseau (de l’ex RFF) et SNCF
Mobilités. Exit donc le gestionnaire indépendant du réseau ferré qui devait
passer par le « transporteur SNCF » pour effectuer ses propres travaux
de voie. Le but serait d’améliorer l’efficacité du système ferroviaire et de
supprimer les doublons et les incohérences, au rang desquelles les lignes TGV
sans rationalité économique et le manque d’entretien du réseau classique.
L’organigramme surprise
Le site Mobilettre créait à la mi-décembre 2014 des
remous avec la publication – reprise ci-dessus – d’un organigramme définitif tranchant
nettement, selon le site, avec ce qu’avait prévu la Loi. Dans cet organigramme,
le réseau devient une simple branche, et non plus un département séparé. La
patte de Guillaume Pépy ? On sait l’homme rusé et communicateur, mais
derrière lui tout un staff faisait pression pour en revenir à la « SNCF
forte et indivisible ». Le patron de l’opérateur a d’ailleurs trouvé un
solide allié en la personne de Jacques Rapoport, l’ex-président de RFF. On se
rappellera que ce dernier a remplacé fin 2012 Hubert du Mesnil, qui avait entamé – et perdu – un bras de fer sur la réforme du système ferroviaire
français. Guillaume Pépy a gagné et la suite est connue.
On remarquera qu'il n'est nullement question ici de « holding » tel qu'on peut l'entendre dans la structure de gouvernance du voisin allemand,
probablement pour affirmer haut et fort le caractère étatique et institutionnel
du chemin de fer français. C’est qu’en France, on ne badine pas avec les
fondements de la République. La SNCF, en dépit d’une relation d’amour/haine paradoxale
avec le peuple, reste ce « Grand Corps d’Etat » qu’affectionne l’Hexagone.
Pour preuve, ce commentaire de haut vol du président de la désormais SNCF Réseau, Jacques
Rapoport : « Notre nouveau bloc‐marque traduit notre appartenance
résolue à la SNCF. Nous portons avec fierté le nom SNCF, nous portons les couleurs
SNCF ». Une conception unique de la chose publique qu’on ne retrouve pas dans les autres Etats de l’Europe, et d'ailleurs le président du Directoire délégué le justifie sans ambages.
Retour à l’ordre ancien ?
Non, rétorque Thierry Marty, membre UNSA du CA de la
grande maison, dans un débat sur LinkedIn : « Le
caractère indissociable et solidaire du groupe public ferroviaire est
entièrement compatible avec l'indépendance des missions d'accès à
l'infrastructure ferroviaire du réseau ferré national, comprenant la
répartition des capacités et la tarification de cette infrastructure qui sont
assurées par SNCF Réseau. Cette indépendance conforme à la la réglementation
européenne est garantie par l'ARAF, autorité de régulation dont les compétences
sont renforcées par la loi du 4 août 2014. Il n'y a donc aucun retour à l'ordre
ancien ». Ce n’est pas l’avis de l’ARAF, l’Autorité de régulation des
activités ferroviaires, qui se montrait déjà très critique dès septembre 2014. L’organigramme,
en effet, ne montre pas non plus d’autonomie de Gares & Connexions, qui fait partie de ce qu’on appelle les « facilités
essentielles », à l’image d’un aéroport où tout le monde est accueilli
sans discrimination.
L'Europe, oui, mais hors de France
Ce n’est un secret pour personne : la France n’a jamais
été d’un enthousiasme débordant pour la remise à flot de l’écosystème
ferroviaire selon les principes de l’Europe. La Belgique et le Luxembourg non
plus ! Nul doute que la SNCF ne souhaite pas se voir imposer une autorité supérieure qui lui fasse de l’ombre. Elle laissera l'ARAF jouer son rôle mais s'en servira comme paravent contre de futures plaintes. Au-delà, la politique prendra le relais. Elle entend redevenir maître du jeu chez elle et s'empresse de faire ses emplettes ailleurs – via Keolis – sur le vaste terrain européen dont elle profite ardemment, et elle a raison . Simplement, cela n’a pas échappé aux députés italiens et allemands qui ont malicieusement introduits une clause de réciprocité dans le quatrième paquet ferroviaire, histoire de rappeler qu'un match de niveau européen ne se joue pas en solo et de façon unilatérale. La bagarre est aussi nationale, quand les Régions se fâchent et demandent des comptes clarifiés, sous peine « d’aller voir ailleurs », ce que permettrait l'Europe dans un futur que la SNCF espère de plus en plus retardé, voire annulé....
Concrètement, on sent une opposition franche et feutrée d’ouvrir le réseau à de nouveaux entrants susceptibles de casser les convictions françaises et de ranimer le volcan social. Sauf peut-être pour le fret ferroviaire, où SNCF semble ne plus trop y croire. Il y a aussi en parallèle une volonté de rapprocher les salariés du privé vers le très onéreux statut public, rendant dès lors inutile toute forme de concurrence. C'est un peu ce qui est recherché par certains, même si personne ne l'avouera face caméra. Les routiers ont de l’avenir…
Concrètement, on sent une opposition franche et feutrée d’ouvrir le réseau à de nouveaux entrants susceptibles de casser les convictions françaises et de ranimer le volcan social. Sauf peut-être pour le fret ferroviaire, où SNCF semble ne plus trop y croire. Il y a aussi en parallèle une volonté de rapprocher les salariés du privé vers le très onéreux statut public, rendant dès lors inutile toute forme de concurrence. C'est un peu ce qui est recherché par certains, même si personne ne l'avouera face caméra. Les routiers ont de l’avenir…
Le nouveau groupe jouera-t-il le jeu ? Restons optimistes. En attendant, les opérateurs européens de fret ferroviaire préfèrent arriver à Bâle via la rive droite du Rhin, en délaissant l'Alsace. On oublie pour le moment la Catalogne en dépit de Perpignan-Figueras, construit à grand frais pour des prunes. Les mètres cubes de rapports produits en 20 ans sur le fret ferroviaire sont bons pour un joli feu de cheminée, c'est de saison. Alors ? A la question posée en juillet 2012, on sait maintenant qui décide du rail en France...
Un bon résumé des faits dans cet article des Echos



.jpg)
.jpg)
.jpg)



.jpg)